-
Par Immergé le 8 Novembre 2015 à 12:27
Corps et biens


Titre : Corps et biens
Auteur : Robert Desnos
Première parution : 1930
Édition lue : NRF (Poésie/Gallimard)
SYNOPSIS
« La coïncidence entre le besoin de projeter ses plus libres fantasmes et, d'autre part, celui d'une "technique poétique" font de Desnos un poète de la surréalité, et donc de la modernité, en même temps qu'un poète qui se rattache à une tradition, celle des grands baroques. C'est là peut-être l'originalité de cette voix si douée qui, avec ses intempérances et ses turbulences, ses écarts, ses inégalités, mais toujours son intensité, est une de celles qui nous forcent le plus manifestement à reconnaître la présence de cette chose spécifique, irréductible, qui s'appelle la poésie. Au reste, et c'est ce qu'il faut dire encore, cette voix était celle d'un homme chez qui le besoin d'expérimenter sous toutes ses formes le langage poétique, allait naturellement avec celui d'expérimenter la vie sous toutes ses formes aussi ; d'un homme qui était plein de passion, curieux et joueur de tout, courageux, généreux et imprudent ; et qui est mort à quarante-cinq ans, dans les circonstances que l'on sait, d'avoir eu ce goût violent de la vie, et donc de la liberté, et d'avoir voulu le pousser jusqu'à ses dernières extrémités. »
René Bertelé.
Robert Desnos est un poète français, né le 4 juillet 1900 à Paris et mort du typhus le 8 juin 1945 (à 44 ans) au camp de concentration de Theresienstadt, en Tchécoslovaquie à peine libéré du joug de l'Allemagne nazie.
Notre paire
Notre paire quiète, ô yeux !
que votre "non" soit sang (t'y fier ?)
que votre araignée rie,
que votre vol honteux soit fête (au fait)
sur la terre (commotion).
Donnez-nous, aux joues réduites,
notre pain quotidien.
Part, donnez-nous, de nos oeufs foncés,
comme nous part donnons
à ceux qui nous ont offensés.
Nounou laissez-nous succomber à la tentation
et d'aile ivrez-nous du mal.Corps et biens. Un monument. Une œuvre résumée, menue, que les camps ont arraché au monde. Mais le monde le méritait-il seulement ?... C'est ce recueil publié en 1930, contenant entre autres Rrose Sélavy, la très célèbre mine de jeux littéraires de Robert Desnos qu'il fait toujours plaisir de relire, auquel je me suis attaqué — quoiqu'il m'ait plus attaqué que je ne l'ai attaqué.
Au mocassin le verbe
Tu me suicides, si docilement.
Je te mourrai pourtant un jour.
Je connaîtrons cette femme idéale
Et lentement je neigerai sur sa bouche.
Et je pleuvrai sans doute même si je fais tard, même si je fais beau temps.
Nous aimez si peu nos yeux
et s'écroulerai cette larme sans
raison bien entendu et sans tristesse.
Sans.Desnos perce et creuse jusqu'au cœur du surréalisme, il mêle les biens — que sont-ils, d'où viennent-ils, que font-ils — et les corps, et les esprits, et les matériaux d'un matériau, et les chaînes d'une chaîne qui relie l'extatique pensée. Il montre ce que nous pouvons faire en la maniant correctement. Est-ce la manier que de la déchirer, de la réduire, de la froisser, de la mâcher, de la disséquer, la langue, aussi ? Ce sont des jeux torturés qui persillent chaque page, chaque bifurcation hasardeuse — le recueil peut en effet se lire dans tous les sens, même si le gauche à droite est préférable. Dans une journée, il y a tant d'occasions d'ouvrir un Desnos que je mourrais volontiers du calcul.
Dans bien longtemps je suis passé par le château des feuilles
Elles jaunissaient lentement dans la mousse
Et loin les coquillages s'accrochaient désespérément aux rochers de la mer
Ton souvenir ou plutôt ta tendre présence était à la même place
Présence transparente et la mienne
Rien n'avait changé mais tout avait vieilli en même temps que mes tempes et mes yeuxJe vois cette œuvre comme un bijou, une base à l'origine de la langue même. Comme si cette base n'avait pas existé avant Desnos. De même, je peine à comprendre que l'on puisse encore se baser sur des poèmes pompeux du XVIIème dans les classes du premier cycle, alors que l'on pourrait s'emparer de R.D. en un éclat vivifiant de vigueur verbale. La vigueur verbale, oui, oh, comme je voudrais en parler ! J'en parle donc : tout passage mérite d'être lu à haute voix distincte et forte et légèrement engluée, d'être utilisé comme un exemple, d'être illustré comme le reste, mis en situation. Corrélé peut-être aussi avec ce que l'on peut corréler pour donner du sens à ce qui n'a aucun besoin de sens.
J'ai tant rêvé de toi, tant marché, parlé, couché avec
ton fantôme qu'il ne me reste plus peut-être, et pourtant,
qu'à être fantôme parmi les fantômes et plus ombre
cent fois que l'ombre qui se promène et se promènera allègrement
sur le cadran solaire de ta vie.Je lui préfère sa forme courte. Elle cingle, atteint, apporte beaucoup de vie — de mon humble avis. Une lecture qui peut faire rire, sourire, pleurer. Une lecture qui console, il faut le dire. Chaque ligne a son importance et son inutilité. Chaque mot a sa place et son degré de solubilité dans un ensemble merveilleusement bien ficelé, fantastique en son sens pur et folklorique, comme un tableau de gaieté cachant une noire réalité... Une lecture qui rassure. Et lorsque la dernière page est tournée, on se sent bien mal...
 1 commentaire
1 commentaire
-
Par Immergé le 29 Octobre 2015 à 21:43
La proximité de la mer
Anthologie de 99 poèmes traduits de l'espagnol (Argentine) par Jacques Ancet

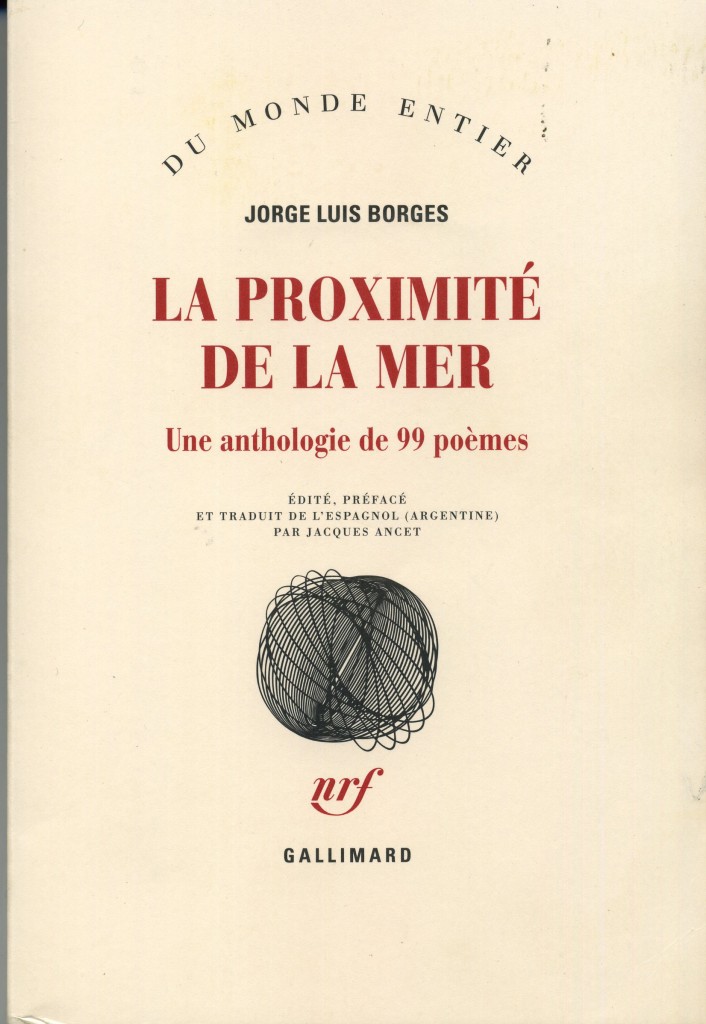
Titre : La proximité de la mer
Auteur : Jorge Luis Borges
Première parution : 2010
Édition lue : Gallimard / Du monde entier
SYNOPSIS
« Malgré une éclipse considérable de trente ans entre son troisième recueil – Cuaderno San Martín (1929) – et son quatrième – L'Auteur (1960) –, durant laquelle il a composé ses proses les plus mémorables, Borges n'a cessé, sinon de publier, du moins d'écrire de la poésie. Peut-être parce que le poème relève pour lui d'une nécessité existentielle. S'il y a recours aux mêmes obsessions et paradoxes qui ont fait la célébrité de ses récits – labyrinthes, tigres et miroirs, jeux sur le temps, l'espace ou l'identité, mais aussi mythologie de faubourgs, de malfrats, de guitare et de couteaux qui est celle de la milonga et du tango, à laquelle il restera attaché toute sa vie –, c'est moins pour nous plonger et nous perdre dans leur fascinant vertige, que pour les interroger ou nous en communiquer mezza voce l'inquiétante familiarité. Dans ses poèmes, Borges médite et chante. Et ce croisement de pensée et d'émotion leur donne ce mélange très particulier de rigueur et d'abandon, d'emphase maîtrisée et de simplicité retorse qui fait leur tonalité singulière. Quelque chose qui hésite, entre le vers bien frappé et la confidence chuchotée, entre l'épique et l'élégiaque, entre le baroque et, nous dit Borges, "non pas la simplicité, qui n'est rien, mais la modeste et secrète complexité."» Jacques Ancet.
Jorge Luis Borges, de son nom complet Jorge Francisco Isidoro Luis Borges Acevedo, est un écrivain argentin de prose et de poésie, né le 24 août 1899 à Buenos Aires, et mort à Genève le 14 juin 1986. Ses travaux dans les champs de l'essai et de la nouvelle sont considérés comme des classiques de la littérature du XXe siècle.
« Roi faible, torve fou, et acharnée,
La reine, tour directe et pion malin
Sur le noir et le blanc de leur chemin
Cherchent et se livrent un combat concerté. »Après avoir lu les nouvelles, je m'attaque donc aux poèmes. C'est par hasard que je vis l'anthologie en librairie, mais la douce perspective de découvrir autre chose que de la prose éparse me plaisait beaucoup. J'avais du reste l'envie de contracter des lectures plus reposées et oublieuses, que je peux écarter quelque temps pour me consacrer à d'autres ; là certainement la triste volonté de se préparer au mois de septembre carnassier et impitoyable avec un peu de tendresse et de mélancolie, que j'avais tant appréciées dans l'extension perpétuelle de la crevasse littéraire dans les Fictions.
« Je suis
Je suis celui qui se sait non moins vain
Que l'observateur vain qui, au miroir,
Silencieux cristal, s'applique à voir
Le reflet ou le corps de son prochain.
Je sais, muets amis, je sais trop bien
Qu'il n'est d'autre vengeance que l'oubli,
D'autre pardon. Un dieu un jour offrit
Cette clef rare à notre haine d'humains.
Hors d'illustres erreurs, je suis celui
Qui n'a pu déchiffrer le labyrinthe,
L'unité innombrable, ardue, distincte,
Du temps, qui est à moi, à tous. Je suis
Personne, pas même un glaive sanglant.
Je suis l'écho, l'oubli et le néant. »L'anthologie dressée par Jacques Ancet s'ouvre sur ces quelques mots de Jorge Luis Borges : « Tout vers devrait avoir deux devoirs : communiquer un fait précis et nous atteindre physiquement comme la proximité de la mer. » Ceci tendant donc à expliquer le titre donné au recueil — assez approximativement, donc, et sans représenter vraiment la globalité de la poésie borgésienne. La majorité des vers évoquent plutôt la littérature, des élucubrations sur le poète et son ego, des évocations épiques et historiques (Ulysse, Œdipe, Protée, Don Quichotte, Polycrate, et des dizaines d'autres), sans oublier des bribes en tous genres, évoquant des moments arrêtés et décortiqués, des passages insignifiants d'une vie et de celles qui l'entourent.
« Est-elle un empire
la lumière qui s'éteint
ou une luciole ? »Suivant la citation, apparaît une longue et soporifique préface — que j'ai lue cependant — où Jacques Ancet dresse d'abord un portrait intéressant de la poésie — je dirais : les deux premières pages —, avant de s'attaquer — je dirais : les vingt pages suivantes — aux traductions antérieures qui lui ont hérissé le poil et lesquelles il fallait absolument pallier à travers cette anthologie, bla-bla-bla. Sachant qu'une bonne partie des lecteurs ignorent ces traductions, cette préface m'a semblé totalement hors sujet, centrée en outre davantage sur le traducteur que sur l'auteur, dont la poésie reste nébuleuse tandis que nous devenons incollables sur la métrique argentine...
« Un homme, il est mort.
Sa barbe ne le sait pas.
Ses ongles s'allongent. »Vient ensuite ce qui me fit languir : les poèmes. J'ai été déçu. D'abord par une répétition presque totale, un recyclage, devrais-je dire, des rimes (j'aurais dû compter celles en "mort/sort" tant elles sont nombreuses), des procédés, des sujets. C'est peut-être la conséquence d'une mauvaise traduction, et il faut que l'on se trouve ici au paroxysme de l'ironie : après un pamphlet de vingt pages sur ses confrères, il serait exceptionnel, pensé-je, que le traducteur ait fait le travail avec ses pieds. Néanmoins, ni l'édition ni moi ne sommes bilingues : je ne peux donc rien affirmer ; de plus, je ne doute pas que ce soit là un grand défi que de s'attaquer à ce qui a déjà été traduit et, surtout, à ce qui provient de Borges.
« UN POÈTE DU XVIII SIÈCLE
Il corrige les brouillons incertains
De son sonnet sans titre, le premier,
Cette page arbitraire où sont mêlés
Des tercets imparfaits et des quatrains.
Lent il les cisèle, plume à la main
Et s'arrête. Lui est-il arrivé
De l'avenir et son horreur sacrée
Une rumeur de rossignols lointains ?
Qu'il n'est pas seul : l'a-t-il senti, au fond,
Que le secret, l'incroyable Apollon
Vient de lui révéler un archétype,
Un avide cristal où tout est pris
De ce qu'ouvre le jour ou clôt la nuit :
Dédale, labyrinthe, énigme, Œdipe ? »J'ai ensuite été déçu par le style en lui-même, qui ne m'a guère touché. Qui ne m'a, en règle générale, pas atteint, bien que certains poèmes m'aient beaucoup plu. On retrouve toujours ce penchant de l'auteur pour la littérature, cette admiration pour Whitman et Macedonio Fernández, pour les mythologies, les échecs, les labyrinthes et les pensées profondes sur le verbe et la personne ; cette même passion qui suinte par tous les pores d'une poésie grandiose — il incombe de le mentionner. Cependant, j'ai pu juger que cette poésie n'est pas de ce qui m'émeut, même si les démarches sur le poète m'ont vraiment intéressé, et le côté répétitif m'a lassé le long de ces 99 poèmes.
« Le plus prodigue amour lui fut donné,
L'amour qui n'espère pas être aimé. »Il y a à partir de la page 159 un groupement de dix-sept haïkus (comptabilisés comme un seul et même poème), lesquels m'ont agréablement surpris. J'ose espérer que ma déception n'est que synonyme de manque d'entraînement et que, si l'occasion s'en présente, je saurai mieux apprécier la plume poétique de Jorge Luis Borges dans un autre recueil — de préférence mieux préfacé !...
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par Immergé le 17 Octobre 2015 à 12:38
Les mouflettes d'Atropos


Titre : Les mouflettes d'Atropos
Auteure : Chloé Delaume
Première parution : 2000
Édition lue : Folio
SYNOPSIS
« Voyez-vous, avant, j'étais prostituée. Depuis, j'ai passé mon Capes. Histoire d'avoir une protection sociale. J'ai eu l'enfance des orphelines. On ne peut pas dire que ce soit gai. Le bonheur non plus, remarquez. Ça dépend d'où vient le plaisir. Mais tout ça reste relatif. Moi j'en aurais des choses à dire sur l'innocence écrabouillée le manque d'amour vrillant l'ulcère l'éternel retour suicidaire la crainte irrationnelle des hommes et l'influence du CAC 40 sur le prix du kilo de navets. Mais je me tais. MOI. Voyez-vous. Je m'astreins au silence. Et c'est très compliqué. Ma logorrhée sismique je la rumine avec l'application d'une charolaise traînant sabots aux portes des vieux abattoirs. Parce qu'il faut être patiente. Et quand sonnera le glas je serai attablée. On ne vous a pas appris la ruse. Guêpières talons aiguilles sécateur enroulé d'un mouchoir de soie caché au fond du sac Kelly. A chacun son Hermès. Trismégiste ou Saint-Honoré. Ça dépend des faubourgs. »
Chloé Delaume, de son vrai nom Nathalie Dalain, née à Versailles le 10 mars 1973, est une écrivaine française. Elle est également éditrice et, de manière plus anecdotique, performeuse, musicienne et chanteuse. Son œuvre littéraire, pour l'essentiel autobiographique, est centrée sur la pratique de la littérature expérimentale et la problématique de l'autofiction. En 1983 se déroule à Paris le drame familial qui hantera toute son œuvre : alors qu'elle n'a que 10 ans, son père tue sa mère devant ses yeux puis se suicide.
Il s'agit du premier roman de Chloé Delaume, que j'ai lu dans la version Folio de deux cents pages environ. Le style est toujours le même, on a des cassures, des phrases écrabouillées, des morceaux poétiques, des bribes, des pensées, des éléments autofictionnels, une sempiternelle recherche de l'original, avec déjà les qualités qu'elle n'aura de cesse de développer plus tard dans ses autres romans : le cynisme, la cruauté, l'humour décalé.
« C'est amusant la haine quand même. ça crée des liens. ça va faire un vide quand on vous aura finie. C'est étonnant aussi la haine, voyez-vous. Moi j'ai tellement de haine. Tellement de haine à l'intérieur. Que je me demande souvent comment un si petit corps peut en contenir autant. C'est vrai. Combien elle peut bien peser toute cette haine. Je me demande souvent. Alors je monte sur ma balance. Et je lis 54 kg. Et je me dis que c'est bien peu 54 kg, pour toute cette haine. Pour toute cette haine si lourde. Tellement plus lourde que ça. »
J'ai eu plus de mal sur celui-ci, après une lecture très colorée, mouvementée et marquante de Le cri du sablier. Le tout m'a paru identique, mais en moins appliqué, moins phonétique, fin, recherché, moins bien agencé peut-être, plus lourd, ennuyeux, redondant ; et, surtout, plus graveleux. Le sujet étant assez spécial : l'auteure se met en scène, la voilà prostituée. Elle décrit à travers des propos très licencieux ses aventures, ses clients, ses problèmes, ses intensions, ce qui se passe dans sa tête. Tout est chamboulé. Elle ne sait pas vraiment où aller. Elle va cependant.
« Possession éreintante infinie. Pérennité de la souffrance. Cristaux déliquescents de rage. Acuité des mouvements accrue. Mécanique moribonde du coït annoncé. Chronique rut barbare virité-jacule. Rejet Marie-Madeleine. Combien de sourires sycophantes. Comme la fourchette d'argent que la Merteuil s'enfonçait sous les ongles en crânant. Combien de supplices Ultrz Brite. Combien de fossettes fossoyeur. Non ça ne peut pas se calculer. Calculez, putains, calculez. »
La langue est plus brute, dure, vulgaire et le style en perd beaucoup, je trouve. Néanmoins, on reste dans un domaine très original, ce terrain où elle s'installe — il faut le rappeler — tout juste, cette pluie qui commence à peine de tomber sur une littérature hébétée, qui semble ne pas comprendre, ne pas vouloir comprendre, qui ne s'expliquera pas. Les références pullulent étrangement, mais l'histoire est à mon sens moins intéressante en ce sens que l'on s'éloigne de l'histoire initiale, de l'autofiction pure — bien que Chloé Delaume tende justement à s'en dégager, à créer ce qui sera qualifié par Fabrice Thumerel d'alteregographie, un terrain neuf, justement, inimitable, inconnu de tous jusqu'à la divulgation de son histoire à travers les romans.
« Elle s'intégra dans une sympathique communauté beatnik du Lubéron, dont les principales activités consistent en la concoction de fromages de brebis, la fabrication de tongs en osier, l'apprentissage de l'art complexe du macramé, et le culte du dieu Zorglobe, entité crystoastrale de la planète Xyploub, venue sur terre afin de sauver une poignée d'élus de l'Apocalypse, grâce à un rituel de purification intertemporel, résidant en l'introduction quotidienne d'une botte de poireaux transgéniques dans l'orifice anal des fidèles. »
Un récit qui m'a semblé long, et c'est la première fois avec cette auteure. J'ai été plutôt déçu et, le livre fini, j'aurais volontiers vomi ces lignes un peu trop crues à mon goût ; pour le style déployé, j'entends. Il fallait que je m'en dégage, c'était assez compliqué. Ce n'est pas un livre que je recommande, comparé à ce dont j'ai pu parler jusqu'à présent.
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par Immergé le 3 Octobre 2015 à 12:45
Le cri du sablier
 (++)
(++)
Titre : Le cri du sablier
Auteure : Chloé Delaume
Première parution : 2001
Édition lue : Folio
SYNOPSIS
« Le livre de Chloé Delaume est le récit d'une réminiscence. Il remonte le temps afin de faire voler en éclats un passé oppressant. Sa virulence a la puissance du cri. Véritable leitmotiv du roman, la métaphore du sablier se propage, se ramifie : elle dessine la figure centrale et traumatisante d'un père «sédimentaire» et d'une «enfant du limon».
Ni pathos ni complaisance. Mais la tentative, à l'âge adulte, de répondre au questionnement d'un enfant, tentative rendue possible par une certaine douceur de l'ironie. Tout passe par le prisme d'une langue singulière, débordante d'inventions. Le style est démesuré, tantôt lapidaire, tantôt abyssal. Les mots se bousculent, deviennent envahissants, jusqu'à donner une impression de fusion. »
Chloé Delaume, de son vrai nom Nathalie Dalain, née à Versailles le 10 mars 1973, est une écrivaine française. Elle est également éditrice et, de manière plus anecdotique, performeuse, musicienne et chanteuse. Son œuvre littéraire, pour l'essentiel autobiographique, est centrée sur la pratique de la littérature expérimentale et la problématique de l'autofiction. En 1983 se déroule à Paris le drame familial qui hantera toute son œuvre : alors qu'elle n'a que 10 ans, son père tue sa mère devant ses yeux puis se suicide.
C'est encore une lecture de Chloé Delaume qui ne m'aura pas laissé indifférent. Chronologiquement, puisque nous sommes toujours dans l'histoire personnelle de l'auteure, une espèce d'autofiction, comme elle le relate elle-même — préférant détacher son propre personnage après l'avoir inclus, pour donner une dimension nouvelle au récit, rendre l'écriture plus complexe et labyrinthique —, Le cri du silence constitue le deuxième livre après Les mouflettes d'Atropos dont je ferai prochainement la chronique.
« Maman se meurt première personne.
Elle disait malaxer malaxer la farine avec trois œufs dedans et un yaourt nature. Papa l’a tuée deuxième personne.
Infinitif et radical.
Chloé se tait troisième personne.
Elle ne parlera plus qu’au futur antérieur.
Car quand s’exécuta enfin le parricide il fut trop imparfait pour ne pas la marquer. »La narration, toujours transcendée, portée jusqu'à un paroxysme singulier et très torturé, une réalité déformée, hachurée, hurlée, déroutée, qui désarme, emporte le lecteur dans cet autre monde, cette caverne abrupte où Chloé Delaume concocte ses romans. Ses romans, des mélanges sauvages, amers, abscons parfois — la lecture n'en est que plus palpitante.
« Comme ça s'appelait l'amour ils firent le nécessaire. Ils n'eurent jamais d'enfants pour contrarier tout le monde et vécurent dans une île retranchée dont le nom fut perdu. Car la confiance luisant le reste importait peu. »
Ce livre est également un vrai dictionnaire. Les mots employés ne se recyclent jamais ; il y a du reste un énorme travail sur la phonétique, comme je l'avais mentionné pour Dans ma maison sous terre. Je l'ai lu d'une traite, parce que je ne pouvais pas faire autrement. J'ai été aspiré. Happé. Par l'histoire de cette enfant arrachée à tout, tout ce qui peut se présenter sur sa route, déracinée, dont les parents sont morts très tragiquement, qui est recueillie comme un morceau de viande avariée par ses oncles racistes, horribles, répugnants et inélégants. L'archétype de la marâtre ; Chloé Delaume, en bonne Cendrillon, transmet avec émotion ce passé extrêmement sombre, le verse longuement à travers ces phrases déformées, ces lignes annihilées, ces espèces de poèmes incorporés ; elle se déverse, oui, dans ce livre, elle se vide, d'un trait, d'un cri.
« Ce n’est pas un spectacle pour les enfants. Conclurent-ils de concert le chœur sut s’accrocher. Dans la cage d’escalier la ribambelle noircie. La concierge coryphait le Kleenex à la main. Vacillante aux cothurnes le vernis fut brossé. A la montée des marches le silence s’imposa dans la crémeuse tension qui suit l’extrême-onction. »
C'est ce cri qui suit la narration, toujours, ce cri que l'on devine, que l'on espère le plus long possible, qui donne des frissons, qui ne peut pas ennuyer, qui ne peut qu'atteindre, toucher, résonner, fort, puissant, indescriptible finalement, intelligible et textuel. Plus techniquement, les phrases sont généralement composées de 6 syllabes. On retrouve beaucoup de néologismes, de noms employés comme adjectifs, de disparitions d'articles, d'emplois en somme propres à la poésie. Un aspect tout à fait descriptif, figé, comme un monologue qui pourrait se prolonger des jours, des nuits entiers. Sous d'autres formes. D'autres aspects. Qui pourrait se partager, qui se partage, ici, du reste, seulement ici, à travers ces pages.
« Or parfois l'on se doit de s'inquiéter d'un songe quand les larves mémorielles incessamment vous rongent. Car pendant des années accoudée à mon lit maman chanta nocturne de ménades homélies. Et ma vie s'engluait dans la déconfiture : quand pourrait-on m'aimer, moi, l'Antigéniture. »
Un chef-d'œuvre expérimental, à mon sens. Le cri du sablier a obtenu le Prix Décembre 2001. C'est pour le moment le roman de Chloé Delaume que je préfère. Pour quiconque souhaite découvrir ses lettres débauchées, rapiécées, malaxées, boueuses et majestueuses, il est à lire absolument. L'expression rester sur le cul n'aura jamais été aussi appropriée.
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par Immergé le 19 Septembre 2015 à 13:02
La chute


Titre : La chute
Auteur : Albert Camus
Première parution : 1956
Édition lue : Folio
SYNOPSIS
« Sur le pont, je passai derrière une forme penchée sur le parapet, et qui semblait regarder le fleuve.De plus près, je distinguai une mince jeune femme, habillée de noir. Entre les cheveux sombres et le col du manteau, on voyait seulement une nuque, fraîche et mouillée, à laquelle je fus sensible. Mais je poursuivis ma route, après une hésitation. J'avais déjà parcouru une cinquantaine de mètres à peu près, lorsque j'entendis le bruit, qui malgré la distance, me parut formidable dans le silence nocturne, d'un corps qui d'abat sur l'eau.Je m'arrêtai net, mais sans me retourner. Presque aussitôt, j'entendis un cri, plusieurs fois répété, qui descendait lui aussi le fleuve, puis s'éteignit brusquement. »
Albert Camus, né le 7 novembre 1913 à Mondovi, près d'Annaba (anciennement Bône), en Algérie, et mort le 4 janvier 1960 à Villeblevin, dans l'Yonne en France, est un écrivain, philosophe, romancier, dramaturge, essayiste et nouvelliste français. Il est aussi journaliste militant engagé dans la Résistance française et, proche des courants libertaires, dans les combats moraux de l'après-guerre. Son œuvre comprend des pièces de théâtre, des romans, des nouvelles, des films, des poèmes et des essais dans lesquels il développe un humanisme fondé sur la prise de conscience de l'absurde de la condition humaine mais aussi sur la révolte comme réponse à l'absurde, révolte qui conduit à l'action et donne un sens au monde et à l'existence, et « alors naît la joie étrange qui aide à vivre et mourir ».
« Pour la modestie, vraiment, j'étais imbattable. »
Pour continuer sur la lignée de L'étranger, que j'ai lu il n'y a pas si longtemps — et il était temps — et auquel je n'ai pas souhaité m'attaquer dans un article, j'ai choisi d'opter pour La chute, un roman qui lui ressemble énormément dans la narration, le style et la technique.
« La vérité c'est comme la lumière, aveugle. Le mensonge, au contraire, est un beau crépuscule qui met chaque objet en valeur. »
C'est l'histoire d'un homme qui se confesse à un autre. Seulement, seul ce premier parle, et seule sa voix s'étend dans le roman, elle seule résonne. Ce procédé tend, d'après quelques analyses, à faire écho au sentiment de malaise qui se distille à travers les paroles de cet homme. Certains de ses propos sur la vie, l'existence, les femmes, les hommes, les étrangers, les sentiments, l'ego, sont très marqués et parfois détestables, ce qui rappelle une fois encore le très célèbre roman qui le précède. Un malaise généralisé, très particulier et reconnaissable entre mille, que Camus manie d'une main de maître.
« Trop de gens ont décidé de se passer de la générosité pour pratiquer la charité. »
Ce roman était plus reposant, je ne l'ai pas lu d'une traite. La lecture était plus fastidieuse, il fallait que je m'arrête, c'est certainement le manque d'action et la placidité de cette narration qui m'a dérangé. Ce classique m'a pourtant bien entraîné : les bizarreries, les anecdotes m'ont fait rentrer dans le vif du récit, et surtout, le principal à retenir de ces mots : l'image de la chute, de la chute sociale, du désintérêt total, de la conscience, cet homme qui assiste finalement au suicide d'une femme, qui l'entend tomber, couler, glisser, se noyer, sans la sauver, qui le raconte calmement, sans regret aucun, en contournant, justement, les regrets éventuels, se figurant que ce bruit n'était qu'habituel. Pourtant, il est poursuivi...
« Je vais vous dire un grand secret... N'attendez pas le Jugement dernier. Il a lieu tous les jours. »
Il y a là également une mine de phrases d'anthologie, des bijoux terrifiants de vérité entre les mains de l'auteur, qui les colle ici, les fait partager, les décortique langoureusement sous les yeux ébahis du lecteur attentif... Une réflexion constante sur tous les sujets traversés, esquissés, retournés, mâchés, toutes les pensées agitées comme dans un vase omniprésent. Une mine horrible sortie des neurones de ce maître de l'absurde.
« Nous ne pouvons affirmer l'innocence de personne, tandis que nous pouvons affirmer à coup sûr la culpabilité de tous. »
Comme d'ordinaire : le roman se termine et je ne sais que penser, qu'interpréter. Je m'incline devant tant de génie, de mystères ; je grave cette atmosphère ténébreuse, ces sillons noirs de la plume de Camus, ce qui s'en dégage encore, longtemps après, dans la mémoire, ce que les mots, puissants, atroces, hypocrites parfois, invoquent lentement, à la manière du bruit qui semble rebondir éternellement dans le caveau cérébral de l'Homme...
 votre commentaire
votre commentaire Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique
Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique
Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique
Une aventure entre les lignes — Chroniques littéraires d'un avide de mots






